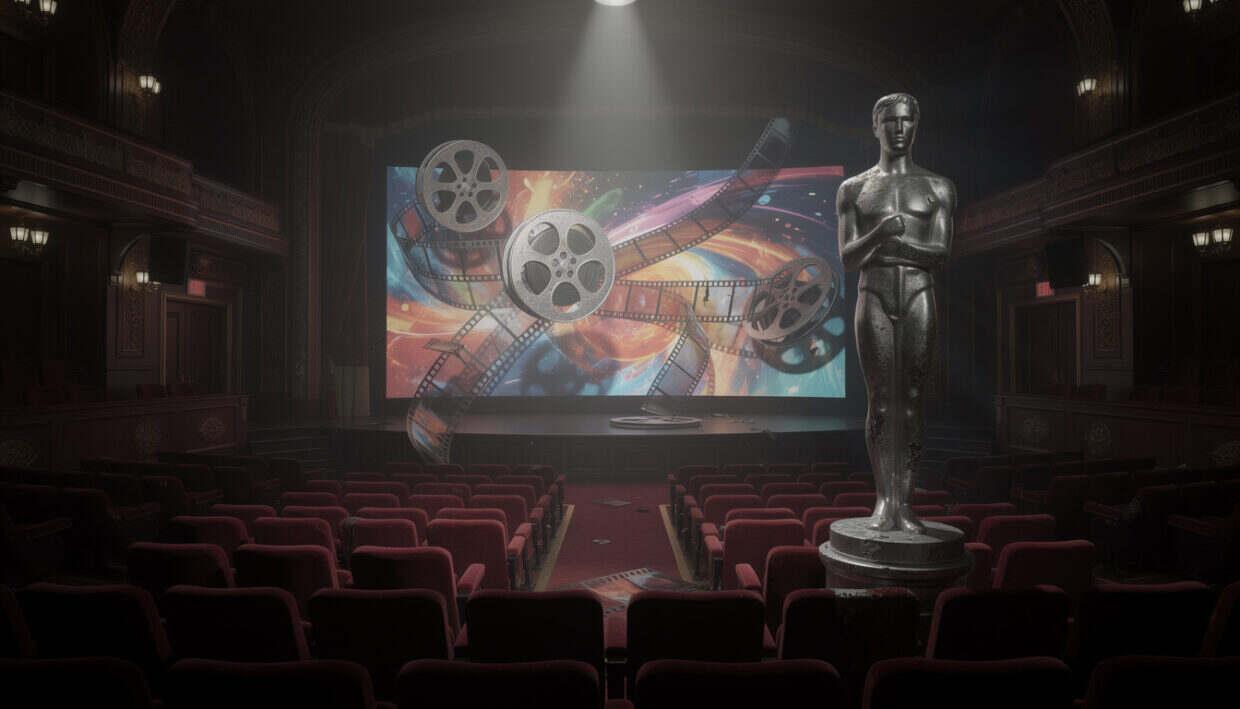Chaque saison des Oscars a son lot d’incompréhensions, mais il existe des années où l’écart entre ce que le public a massivement porté et ce que l’Académie choisit d’honorer devient un sujet en soi. 2026, avec ses nominations portant sur le millésime 2025, donne précisément cette impression-là : une cérémonie qui récompense (en partie) le cinéma qui fait événement, tout en laissant de côté plusieurs titres populaires pourtant centraux dans la conversation cinéphile.
L’exercice n’est pas de réclamer des trophées “au box-office”, ni de demander une représentation arithmétique des entrées. Les Oscars ont historiquement une logique esthétique, politique, parfois générationnelle. Mais quand certains films, incontournables dans les imaginaires de l’année, ne décrochent aucune nomination – pas même dans les catégories techniques où ils semblent “naturels” – la question n’est plus seulement celle du goût : c’est celle de la fonction culturelle de la cérémonie.
Une année où le “grand public” n’est plus un argument suffisant
Le paradoxe, c’est que l’Académie paraît à la fois chercher l’attention du public et s’en méfier. D’un côté, on sait que la retransmission peine à redevenir un rendez-vous vraiment fédérateur ; de l’autre, intégrer de “gros” films peut vite ressembler à un calcul. L’histoire récente a montré, parfois maladroitement, qu’un geste artificiel pour “faire parler” peut se retourner contre la cérémonie. Résultat : prudence, voire crispation.
Pourtant, certaines nominations prouvent qu’un équilibre est possible. Des succès d’envergure ont obtenu de la reconnaissance, et l’on a vu, cette année, des films capables d’unir impact populaire et ambition formelle être mis en avant. Mais cette cohabitation a ses angles morts : plusieurs blockbusters majeurs de 2025 ont été écartés d’un bloc, comme si leur simple appartenance à un genre ou à une franchise suffisait à les rendre invisibles.
Le cas “Ne Zha 2” : l’absence qui dit surtout quelque chose du système
Dans les conversations cinéphiles, le premier étonnement tient à un titre qui, objectivement, a marqué l’année : “Ne Zha 2”, phénomène d’animation et triomphe commercial mondial. Sa non-présence dans la catégorie Meilleur film d’animation ressemble à une anomalie… jusqu’à ce qu’on regarde l’envers du décor. La réalité est parfois moins romantique : un film peut être absent non parce qu’il est rejeté, mais parce qu’il n’a pas été engagé dans la course de manière effective.
C’est là que l’on touche à une dimension souvent mal comprise du public : les Oscars ne sont pas seulement un jugement esthétique, ce sont aussi des campagnes, des stratégies de visibilité, des calendriers, des conditions d’éligibilité, des distributeurs plus ou moins rompus à l’exercice. Dans le cas de “Ne Zha 2”, l’absence renvoie moins à une hostilité à l’animation chinoise qu’à la mécanique – implacable – de l’écosystème des prix.
Sur le fond, cela interroge néanmoins la vocation des Oscars à être une vitrine “mondiale”. Si un des plus grands événements d’animation de l’année n’entre pas dans le radar de l’Académie, c’est que le radar dépend encore beaucoup de la manière dont Hollywood “reçoit” le reste du monde, et de la capacité des films à s’inscrire dans un circuit occidental de prestige.
“Superman” (James Gunn) : quand l’évidence technique ne suffit plus
Autre absence frappante : “Superman” de James Gunn. On pouvait anticiper que le film ne serait pas un candidat naturel aux récompenses majeures – l’Académie reste rarement généreuse envers les récits super-héroïques en tant que tels. Mais l’absence totale, y compris dans des catégories comme Meilleurs effets visuels, laisse un goût de rendez-vous manqué. Pas parce que tout blockbuster mérite un trophée, mais parce que certaines catégories techniques sont précisément censées reconnaître le savoir-faire : composition d’image, intégration numérique, création de mondes, chorégraphie de l’impossible.
Le cas Gunn est intéressant d’un point de vue de mise en scène. Son cinéma, qu’on l’aime ou non, a une grammaire claire : rythme calibré, gestion de la tonalité (l’humour au bord du mélodrame), sens du cadre lisible même dans la densité. Or, les Oscars ont parfois tendance à confondre la “virtuosité discrète” avec l’absence de virtuosité. Un film dont les effets ne crient pas “regardez mon budget” peut paradoxalement paraître moins démonstratif, donc moins récompensable, alors qu’il a justement travaillé la cohérence d’ensemble.
Si vous vous intéressez à l’évolution des franchises Marvel et à leur place dans la culture pop, ce détour peut éclairer le contexte plus large : https://www.nrmagazine.com/films-spider-man-marvel/. On y comprend mieux comment le super-héroïque est devenu, pour une partie de la critique institutionnelle, un genre “trop connu” pour être pris au sérieux – comme si la familiarité annulait la valeur de mise en scène.
Marvel en 2025 : l’effacement des catégories techniques
Le silence autour des sorties Marvel de 2025 – zéro nomination, même dans les domaines artisanaux – est révélateur d’un basculement. Il fut un temps où, sans forcément couronner un film, l’Académie reconnaissait le travail des équipes : son, montage, effets, direction artistique. Aujourd’hui, on sent une lassitude, comme si l’industrialisation d’un style visuel avait fini par rendre ces films interchangeables aux yeux des votants.
Ce n’est pas entièrement injuste : la standardisation existe, et le public lui-même en débat depuis quelques années. Mais l’exclusion totale a aussi quelque chose de paresseux. Car même dans un film contraint par un cahier des charges, il reste des choix : une scène d’action est une question de lisibilité, de tempo, de spatialisation, de montage. Et ces éléments relèvent d’un artisanat qui peut mériter d’être distingué indépendamment du “label”.
Ce rejet global ressemble moins à une évaluation film par film qu’à un vote de bloc, presque idéologique : non pas “ce film ne mérite rien”, mais “ce type de film ne doit plus être récompensé”. On peut le comprendre comme un réflexe de protection du prestige. On peut aussi y voir un aveu : les Oscars peinent à parler d’un cinéma qui, qu’on l’apprécie ou non, est devenu une langue principale du spectacle contemporain.
“Wicked: For Good” : le snub le plus symbolique
Le cas le plus emblématique reste “Wicked: For Good”. Qu’un film aussi exposé, suite d’un premier volet fortement remarqué par l’Académie, reparte sans la moindre nomination, relève moins d’un simple oubli que d’un message implicite. La comparaison avec le premier opus, largement nommé, est inévitable : ici, le deuxième chapitre n’a pas bénéficié de la même bienveillance, ni de la même dynamique critique.
On peut y lire un phénomène que les Oscars connaissent bien : la suite est souvent jugée non seulement sur ce qu’elle est, mais sur un “surplus” d’attente. La barre n’est pas la même. Une suite doit prouver davantage, justifier sa nécessité artistique, éviter l’impression de recyclage. Et lorsqu’un film semble moins surprenant dans sa narration ou plus mécanique dans sa progression dramatique, la sanction peut être brutale, surtout si la réception critique a été plus tiède.
Dans une comédie musicale filmée, la question est aussi celle de la mise en scène du chant : comment le cadre accueille une performance, comment le montage respire, comment les transitions musicales deviennent récit plutôt que simple enchaînement. Si le film paraît plus “géré” que “désiré” – plus production que vision – l’Académie, qui adore les œuvres donnant l’impression d’une nécessité, se détourne vite.
Ce que ces absences racontent de la crise d’attention autour des Oscars
Il serait simpliste d’accuser l’Académie de snobisme pur, ou de réclamer une cérémonie transformée en vitrine des recettes mondiales. Mais une cérémonie gagne à rester une scène où le grand public reconnaît une part de son année de cinéma. Quand les films les plus commentés, les plus vus et parfois les plus influents sont absents, l’événement se replie sur lui-même.
Et ce repli se paie en attention, donc en récit collectif. Les Oscars ont toujours été une machine à fabriquer des “moments” – pas seulement des lauréats. Or, ces moments naissent souvent d’une rencontre entre une œuvre et une audience déjà investie émotionnellement. Sans cet investissement, il reste un palmarès, parfois brillant, mais moins partagé.
Cette tension est d’autant plus vive que Hollywood continue d’utiliser les Oscars comme un moteur : certaines œuvres dites “adultes”, ambitieuses, coûteuses à défendre, existent aussi parce qu’il y a, au bout, la perspective d’une reconnaissance. Mais si le public se sent progressivement exclu de la conversation, le prestige devient endogame. Et un prestige endogame finit par perdre de sa force symbolique.
Des succès nominés… mais une sensation de manque
Il faut le rappeler : l’année n’est pas dépourvue de films “événement” dans la course, et certains ont même raflé un nombre spectaculaire de nominations. Cela prouve que l’Académie n’est pas hermétique au cinéma qui rassemble. Mais cette ouverture semble sélective : elle fonctionne mieux quand le film a, en plus de son succès, une aura d’auteur, un sujet “sérieux”, ou une singularité immédiatement repérable dans le discours médiatique.
À l’inverse, le blockbuster de studio “pur”, même bien tenu, même inventif dans ses séquences, demeure suspect. Le problème n’est pas qu’un film de franchise ne soit pas nommé en Meilleur film. Le problème, c’est quand l’Académie semble oublier que le cinéma est aussi un art d’équipe, et que les catégories techniques sont précisément là pour éviter que la reconnaissance ne se limite au seul prestige narratif.
Le cinéma à budget moyen : l’angle mort qui relie tout
À force d’opposer “petits films” et “mastodontes”, on perd de vue la zone historiquement la plus fertile : le film à budget moyen, celui qui permet l’expérimentation sans l’écrasante obligation du milliard, et sans la fragilité extrême de la micro-production. Beaucoup de la vitalité du cinéma américain d’hier venait de là : des récits de genre élégants, des thrillers nerveux, des drames resserrés, où la mise en scène pouvait être audacieuse sans être justifiée par une franchise.
Sur ce sujet, cette lecture apporte une perspective précieuse sur l’avenir de l’action et de la production “intermédiaire” : https://www.nrmagazine.com/joe-carnahan-realisateur-de-the-grey-devoile-lavenir-des-films-daction-a-budget-moyen-si-tout-tourne-autour-des-actionnaires-cest-la-fin-exclusif/. On comprend mieux pourquoi, dans une industrie polarisée, les Oscars deviennent un champ de bataille symbolique : si tout n’est plus que très grand ou très petit, la cérémonie perd sa capacité à raconter la diversité réelle des formes.
Quand la “filmographie” pèse plus que le film : le réflexe auteuriste… et ses limites
Les Oscars aiment les signatures, les retours, les trajectoires. Cela a du bon : célébrer une œuvre, c’est aussi reconnaître une continuité, une manière de filmer, une vision du monde. Mais ce réflexe peut produire une injustice inverse : on récompense plus volontiers un film parce qu’il s’inscrit dans un récit auteuriste valorisé, et l’on ignore un autre film parce qu’il appartient à une machine jugée impersonnelle, même lorsque des individus talentueux y travaillent avec une vraie personnalité.
La cinéphilie, la vraie, sait pourtant qu’une œuvre se juge aussi à sa capacité à faire exister un style dans la contrainte. Tarantino a construit une partie de son identité sur la réappropriation de formes populaires, sur le montage de références et la musicalité des dialogues. Pour replacer ce débat dans une perspective de culture cinéphile (sans confondre auteur et franchise), ce détour peut nourrir la réflexion : https://www.nrmagazine.com/classement-films-tarantino/.
La question, au fond, n’est pas de dire qu’un blockbuster “mérite” parce qu’il a rapporté. Elle est de se demander si l’Académie est encore capable de reconnaître la mise en scène du spectacle comme un terrain d’art, et pas seulement comme un produit de flux.
La réception critique, les “narratifs” et la sanction collective
Un autre élément, plus discret, influence ces absences : le “narratif” critique. Quand une année est marquée par un discours de fatigue envers un genre (super-héros, suites, univers partagés), chaque film arrive avec un handicap. Il doit d’abord prouver qu’il échappe à la tendance, avant même d’être jugé pour lui-même. À l’inverse, un film plus petit bénéficiera parfois d’un élan de soutien parce qu’il incarne une résistance à l’industrialisation.
C’est humain, et en partie sain : la critique a aussi un rôle de contrepoids. Mais la sanction collective devient problématique lorsqu’elle efface les nuances. Un film peut être imparfait, appartenir à une franchise, et néanmoins proposer une belle direction d’acteurs, un art du découpage, une sophistication sonore, un sens du décor. Le vote “zéro nomination” est rarement une analyse : c’est souvent une posture.
Ce que le public regarde ailleurs : streaming, prescription et nouvelles fenêtres
Enfin, cette fracture entre Oscars et grand public s’accentue parce que la prescription s’est déplacée. Une partie de l’attention cinéphile se fait désormais par listes, discussions en ligne, plateformes, rattrapages continus. Les œuvres ne “existent” plus uniquement au moment de leur sortie en salle, mais dans un écosystème de recommandation permanent, où le spectateur navigue entre nouveautés et catalogue.
Pour comprendre comment cette logique de fenêtre influence les habitudes (et donc la manière dont une œuvre devient “visible”), on peut aussi regarder du côté des sélections et sorties à venir : https://www.nrmagazine.com/films-series-netflix-juillet/. Les Oscars restent une vitrine prestigieuse, mais ils ne sont plus l’unique carrefour d’attention.
Une lecture personnelle : l’Académie juge-t-elle encore le cinéma comme un art du cadre et du rythme ?
Ce qui me frappe, en tant que spectateur qui scrute autant la fabrication que l’émotion, c’est que les snubs de 2025 ressemblent moins à des “erreurs” qu’à un changement de définition implicite du mot cinéma. Comme si certaines formes – le musical de grande ampleur, le super-héroïque, l’action numérique – étaient reléguées à un statut de divertissement inéligible à l’attention artistique, même quand elles déploient un vrai travail de rythme, de chorégraphie, de composition.
Or, l’histoire du cinéma est justement l’histoire d’un art populaire qui n’a cessé de transformer la technique en langage. Les catégories techniques ne sont pas un lot de consolation : elles sont le laboratoire visible de l’invention. Ignorer en bloc des films dont la fabrication a mobilisé des années de travail, des équipes entières, des innovations concrètes, c’est risquer de réduire la cérémonie à une validation de thèmes plutôt qu’à une écoute des formes.
Et pendant que l’Académie resserre son cercle, les spectateurs, eux, continuent de bâtir une cinéphilie transversale, capable de passer d’un drame intimiste à un grand spectacle, d’un film d’auteur à un récit de genre. Cette circulation, on la retrouve jusque dans des sujets très précis, parfois inattendus, comme l’attrait persistant pour des sous-genres ou thématiques que la critique institutionnelle regarde de loin. Exemple amusant, mais révélateur : la manière dont certains publics se fédèrent autour de films à motif animalier ou équestre, hors des radars des prix, et pourtant porteurs d’une vraie tradition de mise en scène et de paysage : https://www.nrmagazine.com/meilleurs-films-chevaux/.
Fin ouverte : ce que ces “films ignorés” nous obligent à regarder autrement
Les Oscars 2026, en ignorant plusieurs des plus gros films de 2025, posent une question simple et inconfortable : la cérémonie veut-elle encore être un miroir – même partiel – de l’année cinéma, ou seulement le reflet d’un territoire esthétique de plus en plus délimité ?
Ce n’est pas un débat entre culture “noble” et culture “pop”. C’est une interrogation sur le regard : à quel endroit l’Académie accepte-t-elle de voir de la mise en scène, du montage, du jeu, de l’invention plastique ? Et à quel endroit décide-t-elle, par principe, que tout cela ne compte plus – même quand des millions de spectateurs l’ont vécu, discuté, comparé, et parfois aimé pour de bonnes raisons ?
Passionné de cinéma depuis toujours, je consacre une grande partie de mon temps libre à la réalisation de courts métrages. À 43 ans, cette passion est devenue une véritable source d’inspiration et de créativité dans ma vie.