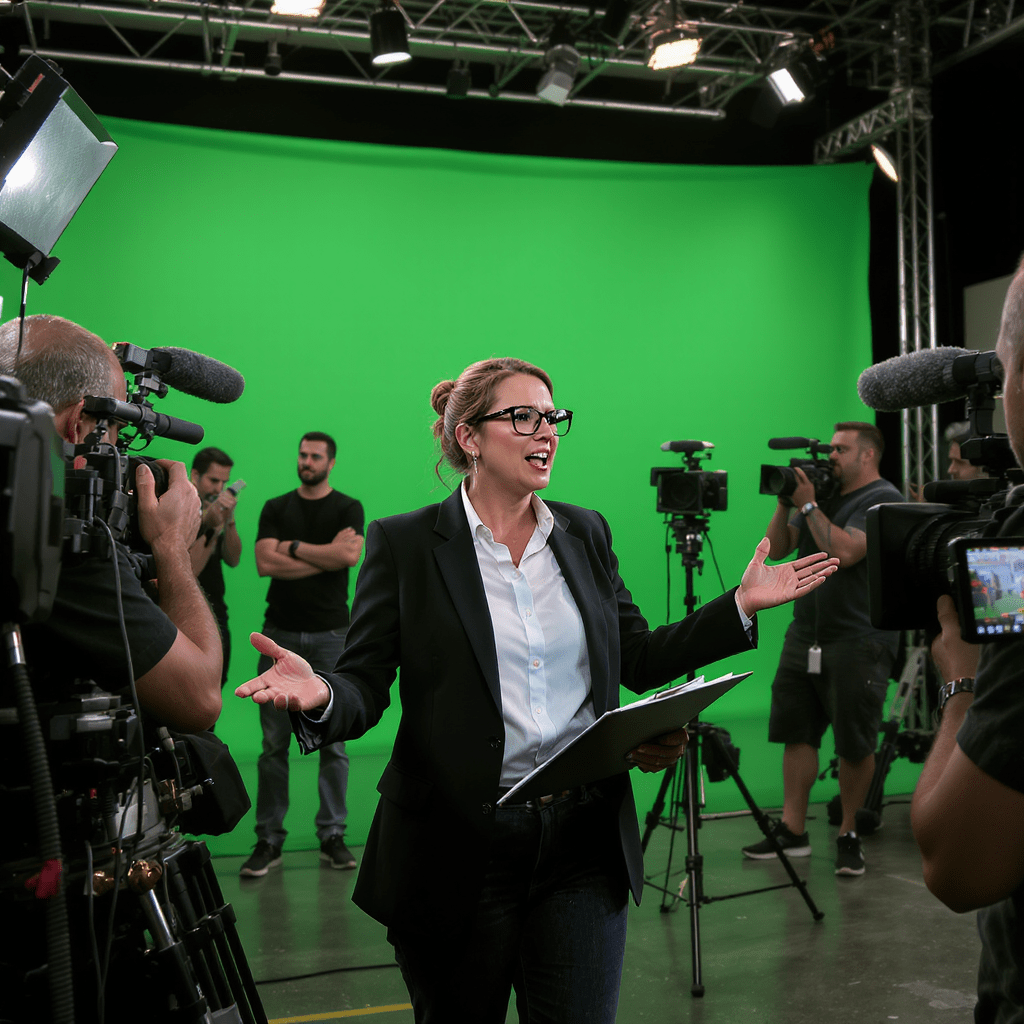Il y a, dans la trajectoire d’un cinéaste, des films fantômes. Des projets si longuement rêvés qu’ils finissent par exister presque autant que les films tournés – sauf qu’ils ne laissent derrière eux ni plans, ni coupes, ni silences montés. Joe Carnahan appartient à cette famille de metteurs en scène dont la filmographie “officielle” raconte une histoire, tandis que la filmographie “impossible” en raconte une autre, plus intime : celle des occasions manquées, des calendriers qui se télescopent et des studios qui changent d’humeur.
Aujourd’hui, c’est au moment où il promeut The Rip, son nouveau long métrage disponible sur Netflix, que Carnahan laisse affleurer l’un de ses grands regrets : le film qu’il aurait voulu faire, celui qui lui a échappé au moment même où il pensait tenir la bonne prise.
De l’adrénaline au contrôle : la place de Carnahan dans le cinéma d’action contemporain
Carnahan n’est pas un nouveau venu. Il a traversé Hollywood en artisan de l’énergie : un cinéma de rythme, de tension, de personnages nerveux, où la mise en scène cherche moins la pose que l’impact. On se souvient de ses films comme d’objets qui avancent vite, parfois trop, mais avec une vraie signature : un goût pour les ensembles sous pression, pour les dialogues qui mordent, et pour une violence filmée comme une mécanique plutôt que comme un spectacle.
Ce positionnement n’est pas anodin à l’heure où le cinéma d’action semble partagé entre deux pôles : d’un côté, les franchises-systèmes, et de l’autre, quelques films “à hauteur d’homme” qui tentent de survivre. Sur ce sujet, les propos du cinéaste résonnent fortement avec l’idée que l’action à budget moyen peut devenir une espèce menacée si la logique financière prend le pas sur toute autre forme d’audace. Pour prolonger cette réflexion, on peut lire cet entretien éclairant : https://www.nrmagazine.com/joe-carnahan-realisateur-de-the-grey-devoile-lavenir-des-films-daction-a-budget-moyen-si-tout-tourne-autour-des-actionnaires-cest-la-fin-exclusif/.
The Rip sur Netflix : un nouvel écrin pour une cinétique très “Carnahan”
The Rip, porté par un duo de stars (Ben Affleck et Matt Damon), arrive dans un contexte où Netflix fonctionne à la fois comme diffuseur mondial et comme machine à réduire les aspérités. C’est là toute l’ambivalence : la plateforme peut offrir une liberté logistique, une rapidité d’exécution, un accès immédiat au public – mais elle peut aussi lisser la perception critique, en intégrant un film à un flux continu où l’événement n’a parfois qu’une durée de vie de quelques jours.
Ce qui intéresse chez Carnahan, c’est justement cette tension entre cinéma de genre et économie de l’attention. Un cinéaste habitué aux frictions du studio system se retrouve avec une autre forme de contrainte : non plus la censure frontale, mais la dilution. Dans ce cadre, son aveu sur le projet qu’il rêvait de tourner prend un relief particulier : il dit quelque chose de l’époque, et pas seulement d’un itinéraire personnel.
Le film qui lui a échappé : Killing Pablo, ou la biographie impossible
Le projet qu’il évoque comme sa grande occasion manquée n’est ni un épisode de franchise géante, ni une adaptation “automatique” pensée pour le box-office. C’est Killing Pablo, un film autour de Pablo Escobar qu’il avait développé avec une implication rare, en s’appuyant sur un livre qu’il dit avoir longuement travaillé, au point d’en faire un scénario dont il reste fier.
On imagine facilement ce que Carnahan pouvait y chercher : un récit où la violence n’est pas un décor mais une logique politique, où le suspense se construit autant dans la traque que dans les zones grises morales, où la mise en scène doit articuler l’intime et le géopolitique sans se contenter d’un vernis “criminel”. Un biopic d’Escobar n’est jamais neutre : soit il bascule dans le mythe (donc la fascination), soit il s’acharne à désamorcer ce mythe – au risque de produire une thèse.
Son regret, pourtant, ne s’exprime pas sous forme d’amertume agressive. La raison est simple : entre-temps, Narcos est arrivé, puissamment, avec sa propre lecture d’Escobar. Et Carnahan reconnaît la force de cette série, au point d’admettre qu’elle a rendu son film plus difficile à justifier dans l’imaginaire collectif. Quand une œuvre s’empare d’un sujet avec suffisamment de précision et d’ampleur, elle reconfigure le territoire : elle occupe l’écran mental du public.
Le vertige du “déjà raconté” : quand une série enterre un film avant sa naissance
Le cas est fascinant, parce qu’il dit quelque chose de notre époque : la concurrence n’est plus seulement entre films, mais entre formats narratifs. Une série de plusieurs saisons peut explorer la durée, déplier les contradictions, multiplier les points de vue, installer un climat. Face à cela, un long métrage doit faire autrement : condenser, styliser, choisir un axe radical, inventer une forme qui justifie la compression.
Dans l’histoire du cinéma, ce n’est pas nouveau : certains sujets “appartiennent” provisoirement à une œuvre qui impose sa grammaire. Mais la série contemporaine accentue le phénomène, car elle crée un rapport d’intimité et d’habitude. Carnahan se heurte donc à une réalité presque esthétique : comment filmer Escobar “après” Narcos sans donner l’impression de rejouer une scène déjà vue, même si le film porterait une autre mise en scène, un autre montage, une autre morale ?
Ce problème du projet qui se dissout dans le calendrier culturel rappelle d’autres chantiers avortés ou réorientés, parfois sur des franchises pourtant puissantes. Les attentes autour des blockbusters, leurs retards, leurs réécritures permanentes, tout cela fabrique aussi des films absents – et parfois plus commentés que certains films présents. Sur la manière dont ces grandes machines avancent sous pression, ce détour est parlant : https://www.nrmagazine.com/mission-impossible-8-tom-cruise/.
Un autre regret majeur : Death Wish, ou l’écart entre un scénario et le film qui sort
Si Killing Pablo incarne le film enterré par le contexte, un autre projet cristallise un regret plus douloureux : Death Wish. Carnahan a, certes, été crédité sur la version finalement sortie, mais il insiste sur un point essentiel pour comprendre la frustration d’un auteur dans l’industrie : être crédité ne signifie pas que le film porte votre vision.
Son scénario, selon lui, n’avait quasiment rien à voir avec le résultat final. Il le décrit même comme l’un de ses meilleurs textes, un objet très spécifique, pensé comme un film presque autonome – utilisant un nom connu, mais sans s’y réduire. Il imaginait notamment une approche différente, située à Los Angeles, avec une autre tonalité, loin d’un simple recyclage de marque.
Ce type d’histoire rappelle une vérité souvent invisible côté spectateur : un film ne naît pas seulement d’un script, mais d’un équilibre fragile entre studio, casting, calendrier, egos, et capacité à protéger une intention de mise en scène. Il suffit d’un conflit créatif, d’un changement de direction ou d’une “meilleure idée” commerciale pour que l’objet devienne autre chose – parfois jusqu’à l’irreconnaissable.
Les franchises comme promesses et pièges : de Bad Boys 3 à l’art du départ
Carnahan a aussi côtoyé ces franchises où l’on croit entrer dans un train déjà en mouvement, en découvrant qu’il change de rails au moindre coup de téléphone. Son passage prolongé sur Bad Boys 3, finalement réalisé sans lui, illustre cette zone grise : on développe, on casse, on reconstruit, puis le projet se fait autrement, avec d’autres arbitrages, d’autres tempéraments.
Pour un cinéaste, la question n’est pas seulement “ai-je été remplacé ?”, mais “qu’est-ce que je pouvais dire, moi, dans ce cadre-là ?”. Certaines franchises tolèrent une patte. D’autres la consomment comme un argument de réunion, avant de la neutraliser au montage ou en préproduction. Carnahan, cinéaste de nerfs plus que de protocole, semble appartenir à ceux qui résistent mal au pilotage automatique.
Nemesis : un super-héros sombre, et l’éternel problème d’un concept “trop simple”
Parmi les autres films disparus de son radar figure Nemesis, adaptation d’un comics de Mark Millar. Carnahan y voyait une base excitante, tout en pointant ce qui, paradoxalement, fragilise certains récits de comics : une prémisse efficace mais “mince”, qui demande une réinvention structurée pour tenir un film entier.
Il y a aussi cette difficulté très contemporaine : quand un concept tourne autour d’une menace politique frontale, l’époque peut le rendre à la fois plus pertinent et plus explosif. Le cinéma de studio, lui, adore la provocation contrôlée, mais redoute souvent les récits qui ressemblent trop à une actualité encore chaude. Le projet devient alors “compliqué” non parce qu’il est impossible à filmer, mais parce qu’il est difficile à vendre, à dater, à rendre acceptable à tous les étages d’une production.
Le détail intéressant, ici, c’est que Netflix possède aujourd’hui des actifs liés à cet univers, ce qui rend théoriquement possibles des résurrections. Mais l’expérience montre que “possible” ne signifie pas “probable” : un film peut rester en suspens pendant des années, jusqu’à ce que la fenêtre se referme définitivement.
La mécanique des projets avortés : un cinéma qui se construit aussi dans l’absence
Ce que révèle l’aveu de Carnahan, ce n’est pas seulement la nostalgie d’un film non tourné. C’est une cartographie des forces qui gouvernent le cinéma populaire : l’effet de concurrence entre œuvres, le poids du timing, la fragilité des projets “adultes” à budget intermédiaire, et la manière dont une série peut redessiner l’imaginaire d’un personnage historique.
À ce titre, son cas résonne avec d’autres récits de films qui ne se font pas, ou plus, parce que la stratégie globale d’un studio ou d’une marque change de cap. Les sagas les plus surveillées sont aussi celles où les projets annoncés peuvent se dissoudre, parfois sans bruit. L’exemple des grands chantiers avortés dans une galaxie très connue est éclairant : https://www.nrmagazine.com/pourquoi-la-trilogie-star-wars-de-rian-johnson-na-jamais-vu-le-jour-selon-kathleen-kennedy/.
Ce que Killing Pablo aurait pu être “version Carnahan” : une hypothèse de mise en scène
Imaginer le Killing Pablo de Carnahan, ce n’est pas jouer au producteur rétroactif. C’est tenter de comprendre ce que son cinéma sait faire, et ce qu’il aurait pu déplacer dans un récit déjà connu. Carnahan est un cinéaste qui filme souvent la pression : des groupes en tension, des décisions prises trop vite, des engrenages qui broient. Un récit sur Escobar, abordé par la traque, la peur diffuse, la corruption ordinaire, aurait pu devenir un film de rythme plus que de tableau, de montage nerveux plus que de fresque.
Là où Narcos prend le temps de l’architecture, Carnahan aurait sans doute cherché l’impact : des scènes plus resserrées, une trajectoire plus tendue, une brutalité moins explicative. Le danger, évidemment, aurait été de perdre la complexité au profit du mouvement. Mais c’est aussi la promesse du cinéma : risquer la condensation pour obtenir une émotion plus immédiate, un geste de mise en scène qui tranche.
L’industrie adore les “histoires vraies”, mais redoute la singularité d’un regard
Le paradoxe, c’est que Hollywood affirme aimer les histoires vraies, mais se montre prudente dès qu’un auteur veut les filmer avec une personnalité trop marquée. Un biopic “facile” est un biopic qui rassure : structure lisible, psychologie simplifiée, violence cadrée. Or Carnahan, quand il est inspiré, préfère l’angle oblique : le personnage saisi dans l’action, la morale laissée en tension, le spectateur mis à contribution.
Ce n’est pas un hasard si les films qui lui échappent sont souvent ceux où l’on sent une tentative de déplacement : un Death Wish plus autonome, un Nemesis réécrit pour épaissir la matière, un Killing Pablo qui aurait demandé une balance délicate entre récit criminel et récit politique. Ce sont des projets qui exigent une confiance, et la confiance est une monnaie rare quand le système cherche d’abord à minimiser l’incertitude.
Une époque de reboots, de plateformes et de calendriers fragiles
Dans ce paysage, la circulation des talents d’un projet à l’autre ressemble parfois à un jeu de chaises musicales. Les plateformes ont accéléré la production, mais elles ont aussi accéléré l’oubli. Les studios continuent de privilégier la marque, mais la marque s’use vite. Et au milieu, des cinéastes comme Carnahan tentent de préserver ce qui fait encore la différence : une voix, une cadence, une façon de cadrer l’action non comme un simple “contenu”, mais comme une écriture.
On le voit aussi dans la manière dont certaines franchises télévisées ou dérivées cherchent à fabriquer une signature à l’intérieur d’un cahier des charges. Même la science-fiction sérielle, souvent très formatée, essaie parfois d’inventer des détails de jeu ou de posture qui deviennent des marqueurs de mise en scène et de personnage. Sur ce déplacement discret du jeu et des signes, ce détour est intéressant : https://www.nrmagazine.com/star-trek-starfleet-academy-holly-hunter-devoile-en-exclusivite-le-mystere-de-la-posture-unique-du-chancelier-ake/.
Pourquoi ces films “qui n’existent pas” nous parlent autant
Un projet avorté agit souvent comme un révélateur. Il nous rappelle que le cinéma n’est pas seulement une suite de sorties, mais une somme de tentatives, de versions, de scénarios, de castings pressentis. Dans le cas de Killing Pablo, il y avait même eu, à une époque, un alignement de planètes avec des acteurs envisagés et une impulsion initiale suffisamment forte pour qu’on croit le film en route. Et puis, comme souvent, la réalité industrielle a repris la main.
Ces récits ont aussi une valeur critique : ils obligent à distinguer ce qu’on aime dans un film (son sujet) et ce qu’on aime dans un cinéma (son regard). Escobar peut être filmé de cent manières, et l’intérêt véritable est souvent là : dans l’écart infime entre deux intentions, entre deux façons de monter une scène, d’utiliser la musique, de diriger un acteur, de décider ce qu’on montre et ce qu’on laisse hors champ.
Le point aveugle du spectateur : ce que l’on ne voit pas, mais qui façonne les films
Quand Carnahan parle de Killing Pablo ou de sa version de Death Wish, il parle aussi, indirectement, de ce qui façonne notre rapport aux films : les arbitrages invisibles. Un film n’est pas seulement le résultat d’un talent, c’est le résultat d’un rapport de forces. Le spectateur ne voit que l’objet fini ; le cinéaste, lui, porte la mémoire de toutes les bifurcations.
C’est peut-être pour cela que son aveu a une portée particulière : il ne cherche pas à réécrire l’histoire, ni à se poser en victime. Il nomme un désir de cinéma. Et ce désir, chez un réalisateur de genre qui travaille la vitesse, la tension et le chaos organisé, ressemble à une question laissée ouverte : qu’aurait donné un Killing Pablo pensé comme un film de crise, au montage tranchant, plutôt que comme une grande chronique ?
Quand un projet tombe, un autre surgit : l’effet domino d’Hollywood
Le plus ironique, parfois, c’est qu’un film annulé ne disparaît jamais complètement : il se transforme en énergie pour un autre projet, en obsession de style, en motif narratif recyclé sous une forme différente. Carnahan continue d’avancer, passe de la salle au streaming, d’un film d’action à un autre, mais on sent que ces films manqués construisent une sorte de contre-filmographie, une bibliothèque de gestes non accomplis.
Et pendant que certains projets se perdent, d’autres se réorganisent brutalement, changent de réalisateur, changent de ton, renaissent sous une autre forme – parfois au prix de secousses internes qui laissent des traces visibles à l’écran. Sur cette idée de bascule et de reconfiguration (à l’échelle d’un film ou d’un récit de production), ce lien offre un contrepoint stimulant : https://www.nrmagazine.com/bouleversement-apocalypse-realisateur/.
Ce que révèle l’aveu de Carnahan sur The Rip, et sur ce qu’on attend d’un cinéaste
En creux, parler de Killing Pablo au moment de The Rip, c’est rappeler qu’un film n’est jamais isolé. Il dialogue avec les films faits, et avec les films rêvés. Carnahan, même lorsqu’il travaille dans un cadre très exposé, reste ce cinéaste qui cherche une prise directe avec le spectateur : une narration qui avance, des corps qui décident, un montage qui tranche, une mise en scène qui préfère l’élan au commentaire.
Reste une question qui dépasse son cas : que voulons-nous, aujourd’hui, des réalisateurs de cinéma d’action et de thriller ? Qu’ils soient des exécutants efficaces dans des dispositifs déjà écrits, ou des auteurs capables de produire un regard, quitte à perdre certaines batailles industrielles ? La réponse n’est pas simple, et elle dépend autant des spectateurs que des décideurs.
Passionné de cinéma depuis toujours, je consacre une grande partie de mon temps libre à la réalisation de courts métrages. À 43 ans, cette passion est devenue une véritable source d’inspiration et de créativité dans ma vie.